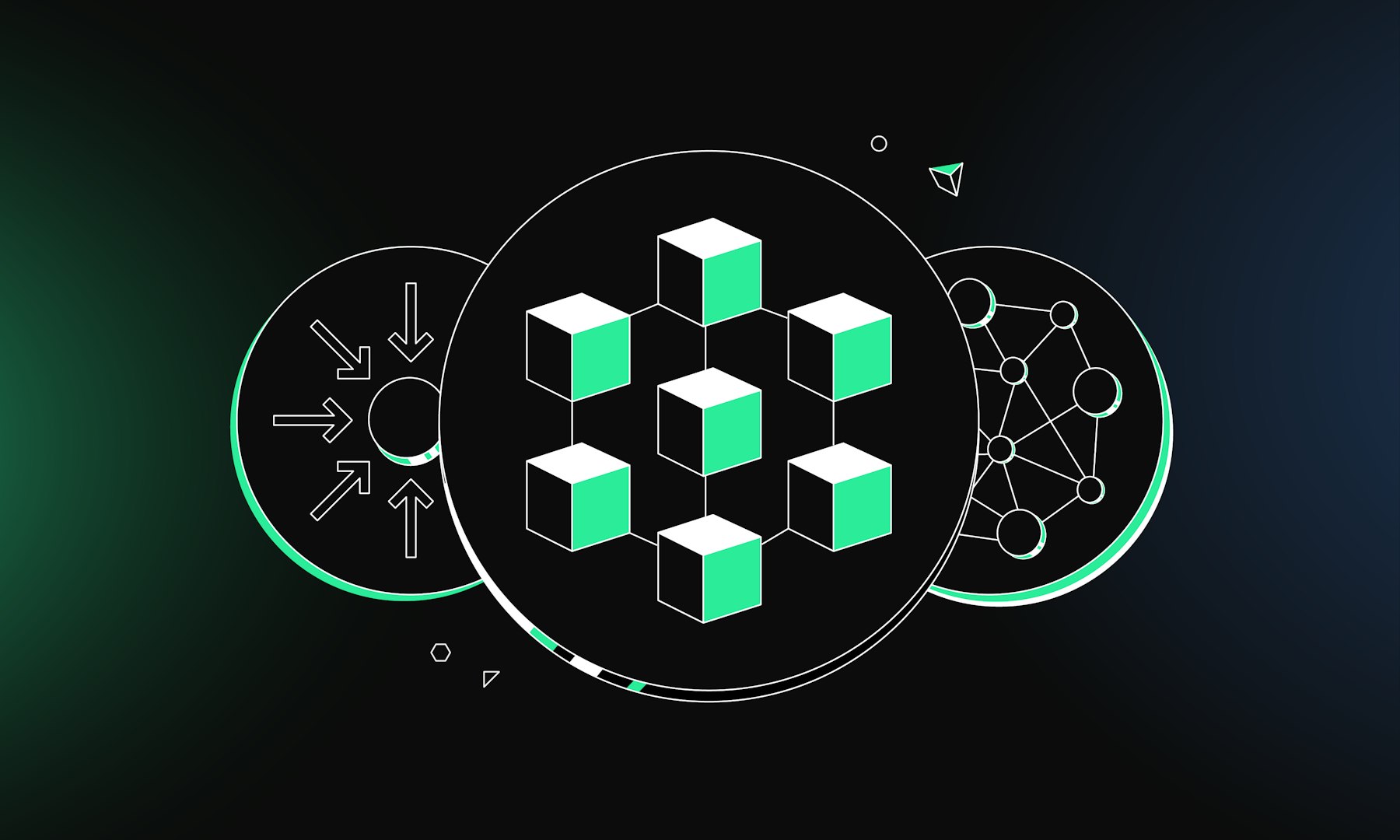Qui a inventé Internet à l’origine ?
Internet tel que nous le connaissons aujourd’hui n’a pas commencé avec les réseaux sociaux ou le commerce en ligne. Il a vu le jour plusieurs décennies plus tôt, enraciné dans un projet de l’époque de la guerre froide mené par les États-Unis, visant à créer un système de communication capable de survivre à une frappe nucléaire. À l’époque, les ordinateurs étaient énormes, coûteux et utilisés principalement dans les milieux militaires et universitaires.
À la fin des années 1960, des chercheurs de l’ARPA (Advanced Research Projects Agency) aux États-Unis ont créé ARPANET, le premier réseau connectant des ordinateurs pour permettre le partage de données. Cette avancée a posé les bases de l’Internet d’aujourd’hui. Et même si beaucoup se demandent qui a inventé Internet, il n’existe pas de nom unique derrière cette invention. C’est une réalisation collective qui a pris forme au fil des années.
Un tournant décisif a eu lieu en 1989, lorsque Tim Berners-Lee a introduit une nouvelle couche d’Internet : le World Wide Web. Plutôt que d’inventer Internet lui-même, il a créé une manière de le parcourir. Son système utilisait des hyperliens pour relier les documents, un langage commun (HTML) pour les structurer, et un protocole (HTTP) pour les transférer. Il a également développé le premier navigateur, permettant à chacun de cliquer, lire et explorer.
Ce changement, qui a transformé un réseau technique en espace convivial, a ouvert la voie à Web1 : la première version du web accessible au grand public.
Web1 : le web statique (années 1990 – début des années 2000)
La première version d’Internet, souvent appelée Web1 ou Internet 1.0, était simple mais révolutionnaire. Cette ère était principalement en lecture seule, ce qui signifie que les utilisateurs pouvaient accéder à l’information, mais sans interagir avec elle. Les sites web agissaient comme des brochures numériques, affichant du texte et des images avec des fonctionnalités minimales.
Principes fondamentaux de Web1 :
Web1 se caractérisait par :
Pages web statiques : le contenu était fixe et ne pouvait pas être modifié par les utilisateurs
Structure décentralisée : les sites étaient hébergés sur des serveurs indépendants, et non contrôlés par de grandes entreprises
Technologie de base : les langages de programmation, logiciels et limites matérielles restreignaient la dynamique et la vitesse des sites. Les mises en page simples en HTML étaient la norme
Pas de fonctionnalités sociales : le web participatif et social n’existait pas encore. Les utilisateurs ne pouvaient pas interagir avec le contenu ou entre eux de manière significative
La bulle Internet et l’essor de Web2
À mesure que l’ère Web1 se développait, l’engouement autour d’Internet a explosé. À la fin des années 1990, les investisseurs croyaient qu’Internet allait transformer l’économie mondiale. Cette croyance a déclenché un afflux massif de financements vers les entreprises en ligne, période aujourd’hui connue sous le nom de « bulle Internet ».
Bon nombre de ces start-ups avaient des modèles économiques limités, mais attiraient pourtant d’importants capitaux-risque. Les prix des actions ont grimpé en flèche, alors que beaucoup de ces entreprises reposaient sur des bases fragiles. La bulle a éclaté au début des années 2000, provoquant d’importantes pertes financières et l’effondrement de nombreuses sociétés. Toutefois, cette période a aussi marqué un tournant. Bien que douloureux pour les investisseurs, le krach a recentré l’attention sur des modèles économiques plus viables et durables.
Ce changement a préparé le terrain pour Web2. Des entreprises comme Google, Amazon et Facebook ont émergé avec des stratégies mieux définies et des plateformes évolutives. Contrairement à Web1, principalement en lecture seule et limité, Web2 a introduit un Internet interactif et centré sur les utilisateurs, où chacun pouvait participer, créer et se connecter d’une manière totalement nouvelle.
Web2 : le web social et interactif (milieu des années 2000 – aujourd’hui)
Web2, aussi connu sous le nom de « web social », a transformé Internet en une plateforme de communication, de collaboration et de commerce. Les réseaux sociaux, l’informatique en nuage et les places de marché en ligne ont rendu le partage et la création plus accessibles que jamais. Ce web a aussi démocratisé le contenu, donnant à chacun les outils pour publier, se connecter et participer, déplaçant le pouvoir des gardiens traditionnels vers les utilisateurs.
Principes fondamentaux de Web2 :
Web2 a introduit plusieurs changements majeurs, comme :
Contenu généré par les utilisateurs : Blogs, réseaux sociaux, plateformes vidéo et forums se sont multipliés.
Expériences basées sur les plateformes : Des entreprises centralisées comme Facebook, Google et Amazon sont devenues dominantes, offrant des services gratuits en échange des données des utilisateurs.
Monétisation des données : Les entreprises ont collecté, analysé et monétisé les données utilisateurs, soulevant des inquiétudes concernant la vie privée et le contrôle.
Évolutivité et accessibilité : Le cloud computing a rendu les services évolutifs et accessibles depuis n’importe quel appareil connecté.
Technologies web avancées et APIs enrichies : Des technologies comme HTML5, CSS3, les frameworks JavaScript et AJAX ont permis de créer des applications web dynamiques et réactives.
Bien que Web2 ait permis la connexion et l’innovation, il a aussi créé des problèmes de centralisation, où quelques entreprises contrôlent d’énormes quantités d’informations. Ces préoccupations ont ouvert la voie à Web3, qui cherche à redonner le pouvoir aux utilisateurs.
Web3 : le web décentralisé et sans intermédiaire (en émergence aujourd’hui)
Web3 représente la prochaine phase d’Internet, s’appuyant sur la technologie blockchain pour privilégier la décentralisation, la sécurité et le contrôle utilisateur. Contrairement à Web2, dominé par des plateformes d’entreprise, Web3 imagine un Internet où les utilisateurs possèdent leur identité numérique et leurs actifs numériques, sans dépendre d’intermédiaires.
Principes fondamentaux de Web3 :
Décentralisation : Les sites et applications décentralisées (dApps) fonctionnent sur des réseaux blockchain plutôt que d’être hébergés par une seule entreprise.
Propriété utilisateur : Les actifs numériques, comme les cryptomonnaies et les NFT, appartiennent aux utilisateurs et non aux plateformes.
Interactions sans confiance : Les contrats intelligents permettent des transactions sécurisées sans intermédiaire, réduisant la dépendance aux banques ou aux grandes entreprises.
Vous souhaitez une introduction simple à Web3 ? Regardez notre vidéo pour découvrir comment la décentralisation, la propriété utilisateur et les interactions sans confiance transforment Internet.